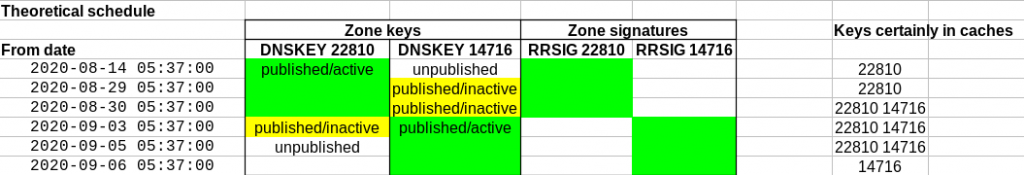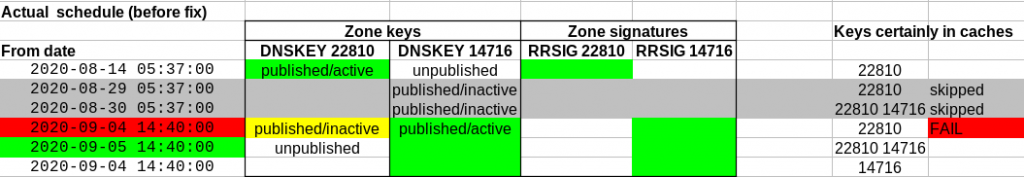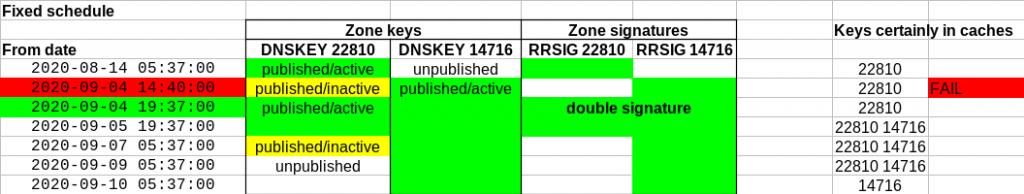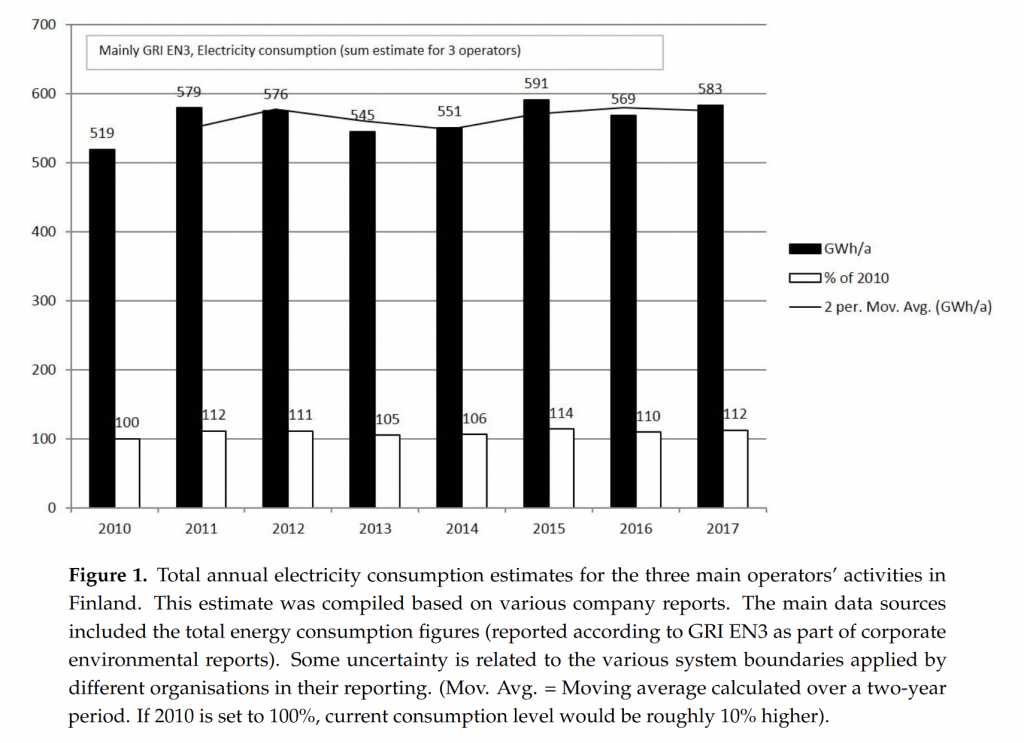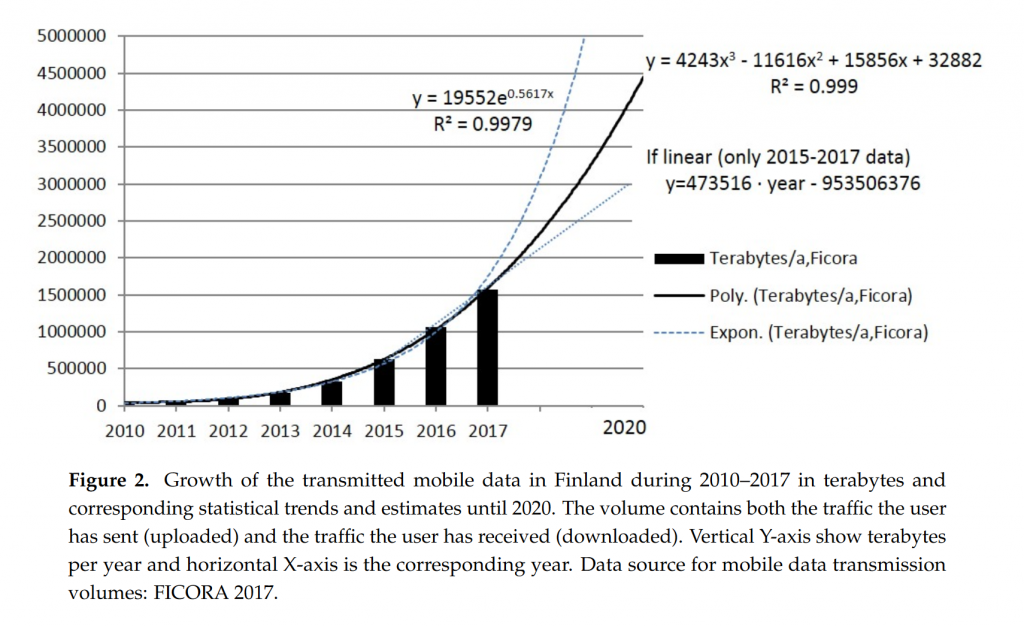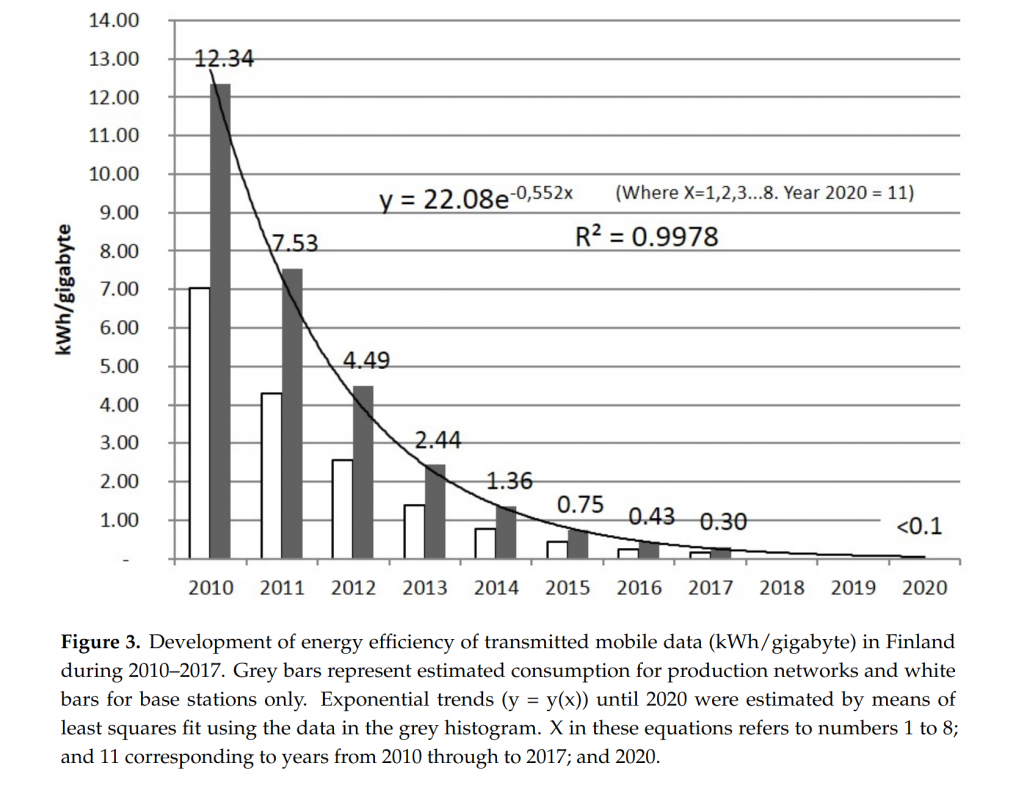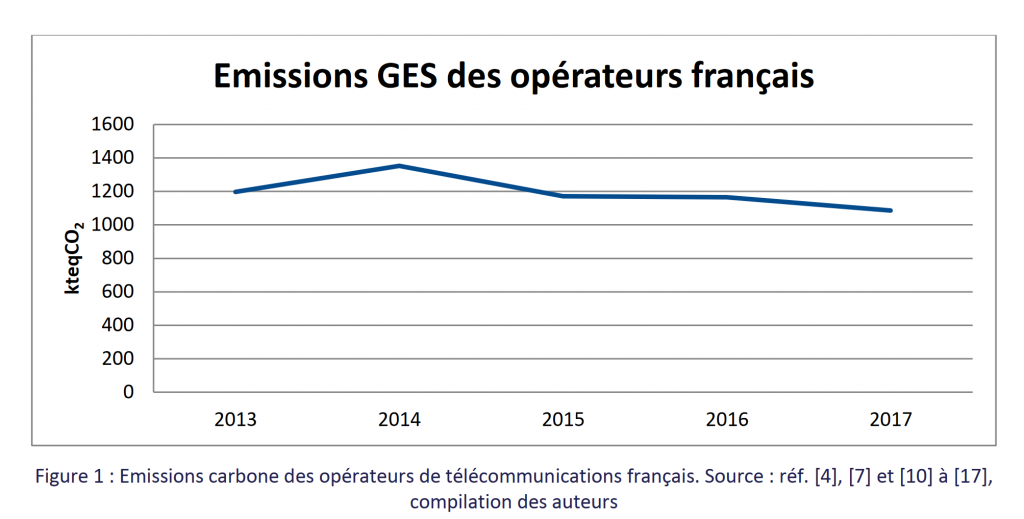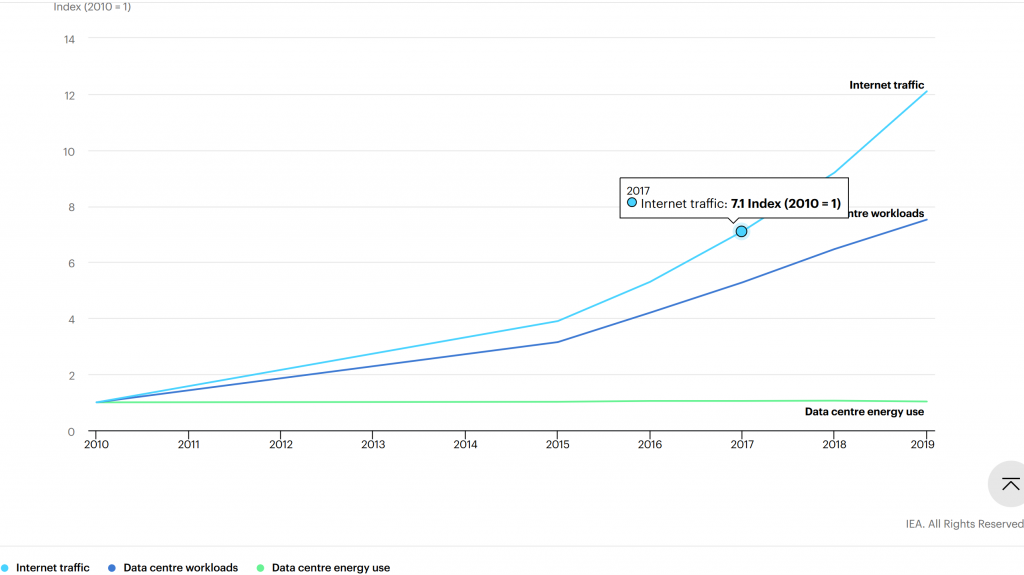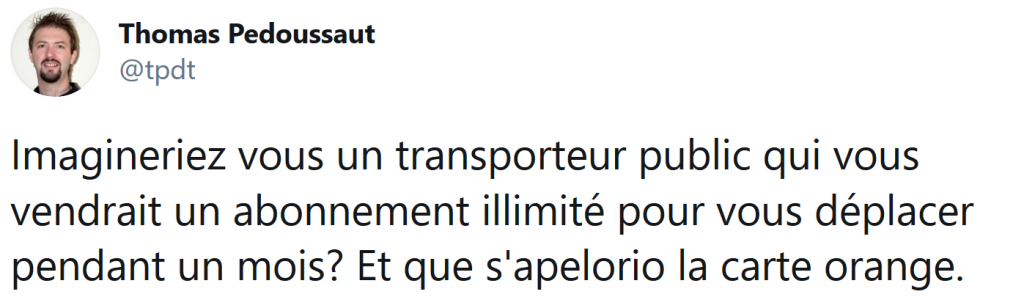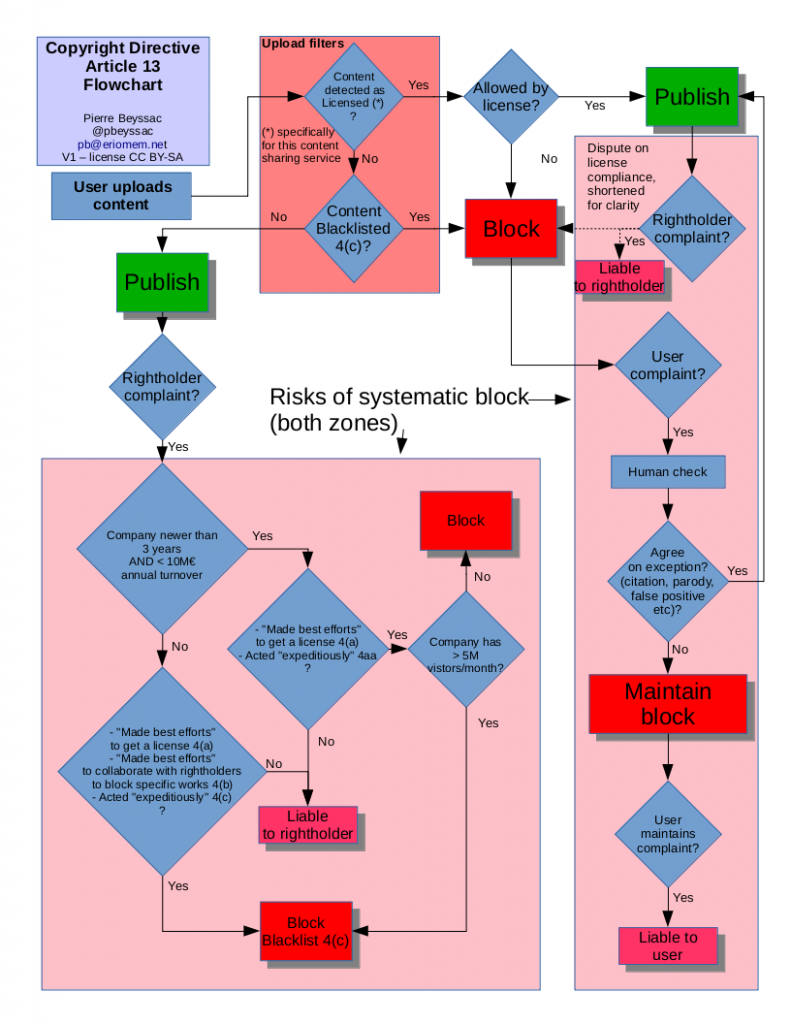On ne présente plus Louis Pouzin : il a été, notamment, l’un des pionniers français des réseaux informatiques, dès les années 1960 et 1970, avec le réseau Cyclades.
Sa biographie vient d’être publiée aux éditions Economica, dans la “Collection Cyberstratégie”, par Chantal Lebrument et Fabien Soyez, avec une préface du blogueur clermontois Korben.

Cette biographie couvre principalement la carrière professionnelle de Louis, mais évoque également sa jeunesse et ses études.
Le livre nous place ainsi au cœur du combat entre les réseaux informatiques et les réseaux télécoms des années 70-90, finalement remporté par les premiers. C’est de ce passé que provient l’insistance maniaque de certains informaticiens l’ayant vécu à parler de réseau informatique plutôt que de réseau de télécommunications.
Le lecteur est plongé dans les affres de la SIMCA, de la société Bull, du Plan Calcul, de l’IRIA (aujourd’hui INRIA), du CNET, et d’un certain nombre d’entités moins connues. La société Bull, notamment, a longtemps défrayé la chronique en France avec ses tentatives pas toujours couronnées de succès (euphémisme) pour populariser sa gamme de machines face à ses gros concurrents états-uniens.
À travers les citations des anciens de Cyclades, le livre évoque aussi une partie des carrières de ces derniers. Ainsi, deux d’entre eux, Michel Gien et Hubert Zimmermann, ont travaillé chez Chorus Systèmes, bien connue dans les années 1990.
On découvre également de l’intérieur l’ambivalence, encore actuelle, d’un état français se voulant stratège, prêt à financer des projets de pointe, mais esclave d’alternances politiques et de raisonnements administrativo-politiques qui ne favorisent pas les meilleurs résultats à long terme, voire produisent des gâchis purs et simples.
L’époque MIT
Après un début de carrière en France, Louis Pouzin a passé une année au MIT, travaillant sur un système d’exploitation bien connu de l’époque : Multics.
Multics fut un des premiers systèmes à “temps partagé” (timesharing) : plusieurs utilisateurs peuvent utiliser simultanément l’ordinateur, et travailler comme s’ils avaient l’ordinateur à eux seuls. Le temps partagé permet un meilleur partage des ressources informatiques, et un travail plus facile. Cela semble très banal aujourd’hui, mais auparavant, les travaux informatiques étaient réalisés par lot : chacun mettait sa tâche dans une file d’attente (souvent, un bac de cartes perforées). Les travaux étaient traités séparément, un par un. Il fallait donc attendre son tour pour voir son travail traité, puis attendre le résultat de celui-ci, le tout pouvant prendre des heures ou des jours. On n’imagine pas le développement agile dans ces conditions…
Là, Louis invente le shell : l’interpréteur de commandes, un élément encore aujourd’hui central dans tous les systèmes.
Le livre évoque cette période, ainsi que, au retour en France, l’évangélisation à travers l’Europe, pour Bull, des clients de la société au timesharing.
Les prémisses de Cyclades : les communications informatiques des années 1970
Dans les années 1970, chaque constructeur informatique avait sa propre gamme, de l’unité centrale aux périphériques, quasi totalement incompatible avec celle de la concurrence. Même les formats de données texte n’étaient pas unifiés, l’ASCII se battant avec l’EBCDIC.
Pour faire communiquer deux ordinateurs sur une longue distance, on utilisait des modems et une ligne téléphonique classique, avec un ordinateur à chaque extrémité, comme pour deux correspondants humains. Ce fonctionnement était défendable pour une utilisation humaine, mais d’une inefficacité catastrophique pour relier des machines.
Tout était donc à créer : l’architecture des réseaux, mais aussi les protocoles d’échange indépendants des architectures de machines.
Cyclades, Arpanet et RCP
Une série de recherches et d’expérimentations ont donc lieu dès la fin des années 1960, essentiellement dans les pays occidentaux, pour réaliser les premiers réseaux informatiques. Ces programmes de recherche ont donné naissance, notamment, à Arpanet, le prédécesseur états-unien d’Internet, mais aussi, côté français, à Cyclades. Il s’agit, à l’époque, d’interconnecter les rares et gros ordinateurs entre eux, et d’en donner accès à distance aux utilisateurs, pour mutualiser les ressources.
Cette période de Cyclades est la plus passionnante et représente presque la moitié du livre.
Le livre couvre en détail la genèse du projet, au sein du Plan Calcul, la constitution de l’équipe — une belle bande de geeks ne comptant pas leurs heures et leurs voyages d’évangélisation, reliés par la passion –, les échanges internationaux nombreux, notamment avec les états-unis, les conférences, les aléas politiques, la reconnaissance des idées et des réussites propres à Cyclades, mais aussi la concurrence avec RCP, le projet monté par le CNET.
Cette partie s’appuie largement sur les travaux de Valérie Schafer et Pierre Mounier-Kuhn sur les débuts de Cyclades et de l’lnternet, qui nous détaillent le processus d’apparition des concepts, attributions et partages, de publication de papiers en reprise par d’autres équipes.
Les divergences principales entre Cyclades et RCP tournent autour de la notion de “paquet”. Dans Cyclades il est transmis tel quel (on finira par l’appeler “datagramme”) ; dans les réseaux d’inspiration télécom, on préfère l’enrober dans un “circuit virtuel”, imitant le fonctionnement du réseau téléphonique (on retrouve la même divergence de culture aux USA, aux débuts d’Arpanet, avec les ingénieurs d’ATT prenant de haut les informaticiens de BBN sur la façon de construire un réseau).
Ce choix du datagramme contre le circuit virtuel a de larges ramifications : le circuit virtuel complique le réseau, le rend moins résilient aux redémarrages d’équipements. Il complique également les interconnexions entre réseaux.
Le livre décrit les tensions entre les équipes Cyclades et RCP, les interventions de la hiérarchie pour faire taire les vilains petits canards, la tentative de fusion des projets, et la décision politique, à l’élection de Valéry Giscard d’Estaing en 1974, de ne poursuivre qu’un seul projet.
Le succès de RCP, X.25, Transpac et le Minitel
C’est RCP, projet issu de l’administration des télécoms, qui, soutenu politiquement, donnera naissance à Transpac (et, en partie, au standard X.25).
Transpac sera, entre autres, utilisé comme support pour le Minitel, et sa première révolution pour l’utilisateur sera la possibilité de communiquer numériquement à travers son propre pays à un tarif indépendant de la distance.
X.25 sera handicapé par son architecture, et en pratique les échanges internationaux fondés sur celui-ci resteront marginaux, éradiqués par un Internet naissant au fonctionnement et tarification plus simples (l’ATM, lui aussi fondé sur les circuits virtuels, qui devait prendre la relève de X.25, connaîtra le même sort funeste, pour des raisons similaires).
Selon Bernard Nivelet, ancien responsable du centre de calcul de l’IRIA, cité dans le livre, “l’attitude de la DGT nous a fait perdre environ 15 ans de maîtrise industrielle”.
Cyclades et TCP/IP
Aux USA, dès 1972-1973, un certain Vinton Cerf qui travaille à la conception de TCP/IP avec Robert Kahn, a compris l’intérêt du travail réalisé sur Cyclades, et s’en inspire.
D’après le livre, c’est dans TCP version 2 (à l’époque, IP et TCP sont traités séparément) que ces idées seront intégrées. Outre l’idée du datagramme, dont Cyclades a été le premier à montrer la faisabilité en réel, TCP/IP reprendra l’idée de fenêtre glissante (qui permet d’adapter la vitesse de transmission à la capacité du réseau), mais aussi les idées sur l’interconnexion des réseaux (le catenet dans les papiers Cyclades, terme repris tel quel dans l’IEN-48 de Vint Cerf en 1978, qui cite Louis Pouzin dès l’introduction).
À leur tour, ces concepts faciliteront la transition “douce” d’Arpanet de son protocole historique vers TCP/IP version 4, par morceaux, en 1983, avant de continuer sa croissance en agrégeant de nouveaux réseaux, aboutissant à l’Internet que nous connaissons.
“Ce sont les américains qui ont sauvé le datagramme”, expose Louis Pouzin. Mais dans Cigale (le réseau physique de Cyclades), “on avait défini que l’adresse destinataire n’était pas un point fixe, hardware (une adresse IP), mais une adresse virtuelle, dans les ordinateurs des utilisateurs”.
Il faut saluer la transparence du livre, qui permet aux anciens de l’équipe Cyclades de rappeler que beaucoup des idées du projet proviennent d’un travail collectif, et s’émeuvent que les projecteurs aient été beaucoup placés sur Louis Pouzin.
L’après Cyclades
La fin du livre évoque les aventures plus récentes de Louis Pouzin : les rencontres d’Autrans, le SMSI, le FGI, RINA, l’internationalisation de l’Internet, et les alternate roots (les racines DNS ne dépendant pas de l’autorité ICANN, sujet controversé qu’il serait trop long de développer ici). Le livre est écrit là sur un ton plus militant, pas toujours facile à suivre, citant quelques anecdotes croustillantes de clashs, notamment entre Louis et les représentants de l’ICANN. On y note une coquille répétée surprenante quoique classique, l'”IUT” pour évoquer l’UIT (ITU en anglais). On y apprend aussi que Louis Pouzin est fan du langage Perl !
Pour terminer sur une note plus personnelle, j’ai eu l’occasion de croiser Louis Pouzin à différentes occasions, la première fois lorsque je travaillais au centre de calcul de l’ENST (école nationale supérieure des télécommunications, maintenant Télécom ParisTech), rue Barrault à Paris. On peut aussi croiser Louis, qui s’intéresse à tout ce qui peut concerner un geek, lors de sessions du FGI comme lors de conférences sur Bitcoin, et il manifeste toujours avec le sourire la même gouaille et la même ardeur à refaire le monde 🙂
Le centre de calcul de l’ENST a été relié à Cyclades, comme l’évoque le livre, par l’un des anciens de l’équipe. À l’époque où j’y ai travaillé, les traces de Cyclades avaient disparu depuis longtemps. Il y aurait également eu une époque où l’école avait été reliée “de force” à RCP pendant sa phase expérimentale. Seul subsistait, au début des années 2000, un lien X.25 utilisé pour le serveur Minitel des résultats du concours Mines-Ponts.
Depuis, le centre de calcul lui même a été déplacé et les locaux totalement reconstruits, lors du désamiantage du bâtiment dans les années 2000.
La première fois que j’ai eu accès à un papier sur Cyclades, Presentation and major design aspects of the CYCLADES computer network, j’ai été frappé par la similarité entre la structure de Cyclades et celle de l’Internet :
CYCLADES uses a packet-switching sub-network, which is a transparent message carrier, completely independent of host-host conventions. While in many ways similar to ARPANET, it presents some distinctive differences in address and message handling, intended to facilitate interconnection with other networks. In particular, addresses can have variable formats, and messages are not delivered in sequence, so that they can flow out of the network through several gates toward an outside target.
Traduction : CYCLADES utilise un sous-réseau à commutation de paquets, qui est un transport transparent de messages, complètement indépendant des conventions hôte-hôte. Bien qu’à de nombreux égards similaire à ARPANET, il présente des différences notables dans la gestion des adresses et des messages, destinées à faciliter l’interconnexion avec d’autres réseaux. En particulier, les adresses peuvent avoir des formats variés, et les messages ne sont pas délivrés en séquence, afin de pouvoir sortir du réseau à travers plusieurs portes vers une cible extérieure)
Ce papier sur Cyclades n’est malheureusement pas disponible librement (on retrouve les problèmes actuels liés à la diffusion des papiers de recherche, un système passant par les fourches caudines des éditeurs de recherche, rendu caduc par Internet). Il date de janvier 1973, pour des concepts qui n’ont été réellement déployés qu’à partir de 1982-1983 dans l’Internet.
Louis Pouzin explique même dans le livre que TCP/IP ne va pas jusqu’au bout des idées de Cyclades sur l’adressage, qui étaient (de ce que j’en ai compris) destinées à permettre l’interconnexion de réseaux hétérogènes.
C’est là que s’arrêtent la plupart des travaux récents que j’ai pu lire sur ces sujets : on aimerait des détails plus techniques sur les fondamentaux de Cyclades, et notamment son format de paquet et ses protocoles élémentaires, que je n’ai réussi à retrouver nulle part à ce jour.
Un livre relatant l’histoire du côté RCP apporterait peut-être, également, un éclairage intéressant sur cette période.
En conclusion, je recommande vivement la lecture de ce livre à ceux qui veulent en savoir plus sur Louis Pouzin, mais aussi lire de belles histoires de geeks passionnés sur le réseau Cyclades, les avatars du Plan Calcul, le tout dans un contexte où l’informatique naissante était très différente de l’environnement que nous connaissons aujourd’hui, mais qui a littéralement construit les réseaux que nous utilisons maintenant quotidiennement.
Complément
On lira également avec intérêt la fiche de lecture de Laurent Bloch sur son blog, qui entre dans des explications détaillées sur le datagramme, la fenêtre glissante, ainsi que le modèle OSI, une autre contribution essentielle, dont je n’ai pas parlé ici.
Deux articles de Fabien Soyez sur Louis Pouzin, “à la base du livre” pour le citer : Louis Pouzin n’a pas inventé Internet, mais sans lui, il n’y aurait pas d’Internet partie 1 et partie 2.
Commentaire intéressant de Chantal Lebrument (co auteure), sur twitter :
Avoir trouvé un éditeur qui accepte ce livre a pris 2ans, tous ont refusé… donc bien contente qu’une maison d’édition de qualité ait décidé de porter ce projet.
On peut trouver le livre en ligne notamment chez :